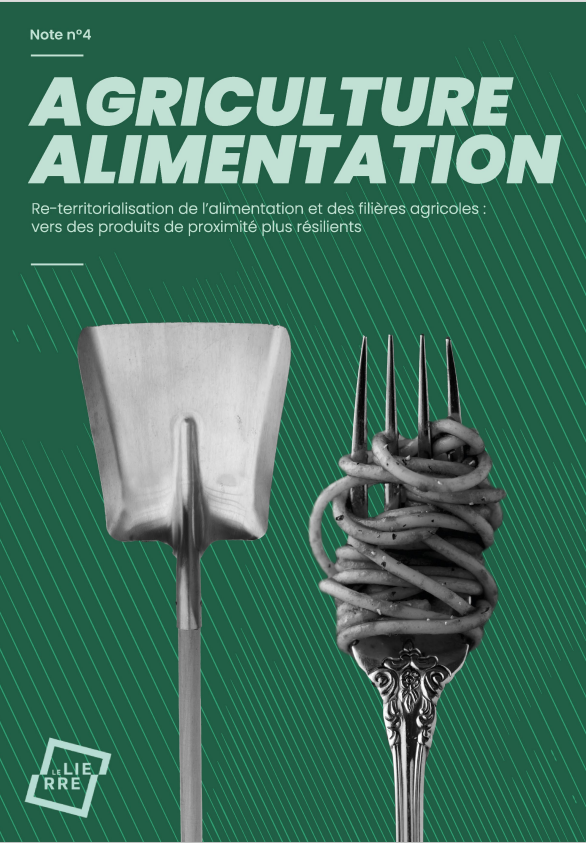La proposition de loi “TRACE” discuté mi-mars prochain au Sénat propose d’instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols concertée avec les élus locaux. Dans la perspective des débats parlementaires, le groupe Aménagement du territoire du Lierre analyse – dans cette tribune parue dans la Gazette des communes – les enjeux du ZAN et les inconvénients apportés par cette proposition de loi qui détricote dangereusement le cap nécessaire de la sobriété foncière.

N’oublions pas les raisons d’être du ZAN : Les sols sont le support et le lieu d’habitat de la biodiversité, ils nous nourrissent, ils régulent les bioagresseurs et les maladies, préservant la santé des plantes, ils régulent le cycle de l’eau, ses flux et sa qualité, prévenant les inondations et nous donnant accès à de l’eau potable ; ils captent le carbone. L’artificialisation galopante qui détruit les sols pose un vrai risque dont nous mesurons aujourd’hui parfaitement les conséquences – sans parvenir encore à en traiter l’origine. En France, plus de 20 000 hectares de sols sont artificialisés par an1.
Le ZAN devrait être un impondérable parce qu’il permet de préserver une ressource essentielle qui ne l’était pas suffisamment jusqu’à présent : l’assouplissement prévu dans la proposition de loi sénatoriale est contre-productif, ne faisant que reporter la nécessité d’agir.
Ainsi entre autres mesures, la proposition de loi “TRACE”2 prévoit non seulement de supprimer l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation d’ici 2030, mais elle va jusqu’à modifier la définition juridique de l’artificialisation : non plus “l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol”, mais seulement “la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”. Cette reformulation appauvrit le sens du ZAN et ignore la dimension qualitative de la fonction écologique des sols.
Plutôt que d’abroger l’objectif intermédiaire à 2030 initial, il faudrait concentrer tous les efforts sur les moyens – techniques et financiers – à trouver pour l’atteindre.
L’argument des « maires bâtisseurs »
Comme ses prédécesseurs, le Premier ministre a promis de soutenir les « maires bâtisseurs » lors de sa déclaration de politique générale le 14 janvier 2025. Mais cette vision, quelque peu désuète et décalée au regard des enjeux actuels, mérite d’être remise en question.
Le développement du territoire et la mise en œuvre de nouveaux projets ne doit plus se traduire systématiquement par la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.
L’attractivité d’un territoire passe également par l’amélioration du cadre de vie et donc par le réusage et la rénovation du bâti et des espaces urbains existants. Il faut donner les moyens aux élus de favoriser à chaque fois des approches alternatives, comme la densification urbaine et la requalification. En prenant en compte les enjeux locaux, les besoins réels en logements et la nécessaire réindustrialisation des territoires, il faut pouvoir arbitrer et innover non pas contre, mais dans le cadre du ZAN.
Ces solutions sont souvent plus complexes et plus coûteuses, certes, mais seulement si on en a une approche à court terme. Il faut changer nos manières de faire en nous adaptant à cette nouvelle trajectoire de l’aménagement, qui peut d’ailleurs favoriser la créativité et l’émergence de nouveaux métiers et de nouvelles filières.
Il ne s’agit pas d’éluder les difficultés de mise en œuvre du ZAN bien réelles, mais ce qu’il faut savoir c’est que des solutions existent et doivent être expérimentées, y compris pour adresser la diversité des contextes territoriaux des collectivité : plusieurs associations et instituts ont déjà fait des propositions concrètes d’outils fiscaux, techniques et juridiques pour y répondre.
De fait, plusieurs territoires ont déjà fait d’immenses progrès dans le domaine de la sobriété foncière et de la préservation des sols, les retours d’expériences réussies en ce domaine ne manquent pas. On peut à ce titre mentionner les cinq régions (Bretagne, Normandie, Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France) qui ont déjà adopté la mise à jour de leurs schémas d’aménagement (SRADDET).
Malheureusement, la position de cette PPL fait l’inverse : partir de l’existant, ne rien changer, en dépit du fait manifeste que tout change autour de nous. C’est un retour en arrière. Il semble pourtant incohérent de vouloir conserver des manières de faire héritées de la France des années 1970 quand le béton coulait à flot, les matériaux étaient peu chers et le pétrole abondant. Face aux défis actuels, le gouvernement en tant que garant de l’intérêt général, doit pouvoir faire preuve de vision, d’ambition et de courage politique. Les aléas climatiques, l’extinction de la biodiversité, les conflits d’usages, ne disparaîtront pas magiquement en mettant le ZAN sous le tapis.
Améliorer, pas affaiblir
Détricoter le ZAN, c’est également balayer d’un revers de manche les efforts réalisés par les nombreux acteurs dans les régions, les communes, les métropoles, les instances déconcentrées…qui ont œuvré depuis 2021 pour le mettre en œuvre.
C’est le rôle de l’État et du service public que d’avoir une vision ambitieuse des efforts à fournir tout en donnant de réels moyens aux collectivités pour la mettre en œuvre. Des élus locaux se sont exprimés en ce sens dans une tribune récente, demandant à ce qu’il n’y ait pas de retour en arrière.3
Le mérite du débat actuel autour du ZAN est qu’il met en lumière une interrogation plus profonde : à quand la fin du pointillisme politique et de la multiplication des plans et programmes sans cohérence les uns avec les autres ?
Quand serons-nous capables de construire avec les collectivités territoriales une stratégie d’aménagement du territoire suffisamment ambitieuse pour faire face aux enjeux actuels, économiques, démographiques et écologiques ?
Il est temps que l’État affirme, au côté des collectivités territoriales, un rôle plus fort en faveur de la régulation et de la préservation des espaces naturels, en adressant les contradictions manifestes. Cela nécessite une vision claire, qui ne cède pas face aux pressions ou aux résistances, mais qui place l’intérêt général au cœur de ses décisions.
Une tribune du Groupe de Travail Aménagement et Territoire du Lierre
à retrouver sur le site de La Gazette
- Cerema, mai 2024. ↩︎
- PPL “Trajectoire de Réduction de l’Artificialisation Concertée avec les Elus” déposée au Sénat le 7 novembre 2024. ↩︎
- https://www.lagazettedescommunes.com/956885/zan-les-elus-locaux-demandent-des-solutions-pas
un-abandon/ ↩︎